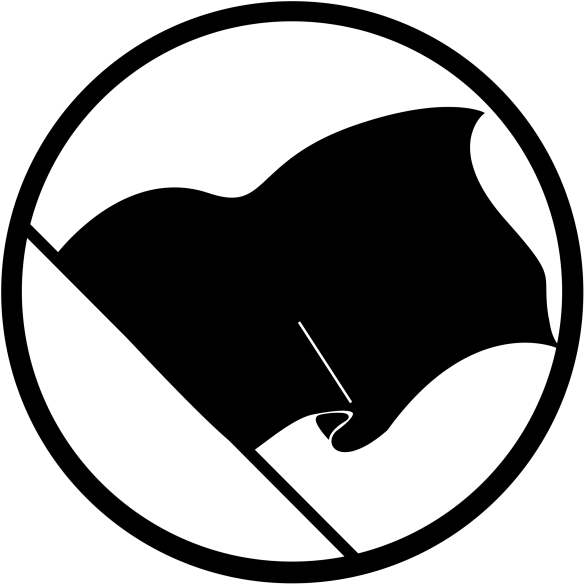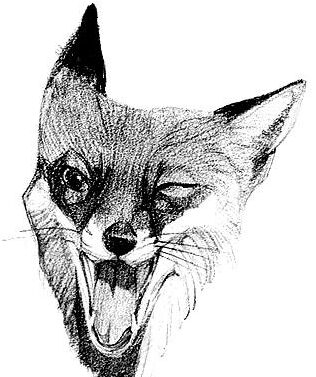Gastronomie et anarchisme. Ou la formidable utopie d’allier fourneaux, barricades, plaisir et liberté.
Par Nelson Méndez, trad. par Sébastien Rutés, éd. Nada, 2023, 110 p.

Ce petit livre est le résultat d’un travail de recherche (ébauché dans un mémoire et deux interventions) mené par Nelson Méndez, un militant anarchiste de longue date, qui a œuvré au Vénézuela. Clair et facile d’accès, il offre un panorama historique et internationale des relations entre la gastronomie, qui ne désigne pas ici la nourriture élitiste et hors-de-prix, et anarchie, qui n’est ni le chaos ni une vieillerie dépassée et centrée sur l’Europe. Synonyme en fait d’alimentation dans le livre, la « gastronomie » est plutôt définie comme un champ de recherche qui étudie l’ensemble des liens entre l’alimentation et une culture, ce qui implique donc une dimension socio-politique. L’anarchisme est présenté quant à lui en cinq points (pp. 16-17) que l’on pourrait résumer ainsi : il s’agit (1) d’une « philosophie sociale » dont les piliers sont l’égalité et la liberté individuelles et collectives, (2) qui vise un projet rationnel de société autogestionnaire, (3) du fait d’une « critique radicale de l’État » comme « concentration autoritaire des pouvoirs ». En ce sens, il implique (4) une transformation sociale révolutionnaire basée sur « l’action directe » (pas nécessairement violente) pour atteindre un « fédéralisme local » (5) rejetant par là la patrie et l’État-nation au profit de l’internationalisme. A partir de là, étant question de changement radical, l’auteur évoque 3 niveaux d’action (individuel, collectif, structurel, cf. pp. 20-21) sur l’alimentation mais qu’il va brasser toutefois en suivant une présentation chronologique.
Point de départ de la réflexion et référence récurrente pour la suite de l’histoire de l’anarchisme, La Conquête du pain (1892) est un recueil d’articles de Pierre Kropotkine, parlant notamment d’agriculture, de production et de consommation, et, dans un esprit pratique, évoquant par exemple des liens d’entraide entre les villes et les campagnes. L’anarchiste russe invite ni plus ni moins à faire de l’alimentation le sujet premier en vue d’une révolution, reposant sur l’égalité mais aussi compris par N. Mendéz comme un « communisme de la variété » (p. 26, par opposition aux socialismes autoritaires, comme au Vénézuela justement), c’est-à-dire en l’occurrence défendant aussi le droit au plaisir de manger et la diversité des goûts.
La question a été traitée ensuite par les anarchistes naturiens, avec un fort accent individualiste (libertaire) mais tentés par des réalisations collectives concrètes, comme celles des communautés, mettant en critique l’industrie capitaliste et promouvant différents modes de vie alternatifs (le nudisme, un rapport plus « ouvert » à la sexualité), qui s’accompagne d’une réflexion sur la santé (comme l’antialcoolisme) et en particulier sur les régimes alimentaires. C’est notamment une entrée du végétarisme dans l’anarchisme, et même si, sur ce sujet, pour le plus connu, Élisée Reclus aurait pu être évoqué, l’auteur cite un certain nombre de références bibliographiques. Présent en France, le mouvement est relativement massif en Espagne également, avec des groupes, des journaux, des livres ou encore des lieux amenant même l’auteur à parler de « naturisme prolétaire » (p. 30).
Moins connu peut-être aujourd’hui, c’est ensuite l’anarcho-syndicalisme, particulièrement fort à la charnière du XIXe et XXe siècles, qui a la part belle. Une partie est consacrée aux activités en Amérique latine : ainsi, il est question de la corporation des boulangers argentins de la fin du XIXe siècle, qui donnera ensuite naissance au FOA, syndicat affirmant de plus en plus son anarchisme en devenant FORA (« Federacion Obrera Regional Argentina ») à partir de 1904. Celui-ci va inclure de très nombreuses fédérations de différents métiers de bouche, ce que l’on retrouve au Pérou ou au Mexique. En Bolivie, on évoque même un syndicat féminin et « cholas » (métis ou indigène), le « Sindicato de Culinarias », tandis qu’à Cuba le mouvement ouvrier s’occupait d’un journal important intitulé « Solidaridad Gastronomica », devenu le périodique du mouvement anarchiste (avant la répression). Dès sa préparation et pendant toute sa durée, la révolution en Espagne (1936-39), appuyée par le syndicat de la CNT (Confédération Nationale du Travail) et par l’organisation de la FAI (Fédération Anarchiste Ibérique), a aussi été marquée par cet engagement : entre autres choses, à Barcelone, 36 cantines ont été montées, avec un travail sur la quantité et la qualité, permettant à la révolution de tenir malgré une situation difficile et (dé)montrant la possibilité de s’organiser de manière anarchiste pour répondre à des besoins vitaux.
Pour résumer, Nelson Méndez montre bien que, par-delà la pluralité des approches de l’anarchisme, qu’il aborde moins par des grandes figures que par des tendances, l’alimentation s’y retrouve régulièrement comme un enjeu de première importance.
Loin d’être éteint, l’anarchisme contemporain a continué à s’intéresser à l’alimentation. En effet, apparaissent de nouveau des lieux de restauration, des coopératives alimentaires, des communautés agraires ainsi que des actions de désobéissance (contre les OGM par exemple). Issu du mouvement (anarcho)punk des années 1970-80, émerge également le retour des liens entre anarchisme et végétarisme par le véganisme – ce qui n’est pas sans débat – du fait de militant.e.s s’intéressant à la libération animale sans perdre de vue l’exploitation humaine (on parle parfois de « véganarchisme »). S’en suivent 3 exemples variés d’engagement actuel : cantines de rue, initiatives culturelles, critique du travail dans la restauration.
– Concernant les cantines, c’est Food not bombs (« de la nourriture, pas des bombes ») qui paraît la plus développée numériquement : naissant du mouvement antinucléaire et pacifiste dans les années 1980 aux États-Unis et désormais repris par 200 collectifs dans 53 pays, cette initiative d’abord réprimée se revendique aussi d’un ancrage anticapitaliste (en récupérant la surproduction) et clairement anarchiste (leur manifeste de 2015 est intitulé The Anarchist Cookbook).
– En Italie, Cucine del Popolo (« cuisines du peuple ») est un projet de membres de la Fédération Anarchiste italienne (Fai), qui, depuis 2003, produit de l’agitation autour de l’alimentation avec une cantine autogérée, anticapitaliste et végé’, auxquels sont articulés divers événements, dont une biennale déclinant la thématique, avec des études sur le sujet, et un intérêt pour les pratiques culinaires populaires, dans une optique révolutionnaire.
– Le dernier exemple présenté dans le livre est une brochure étasunienne de 2006 longuement citée et intitulée A bas les restaurants (traduite ici en français). Réalisée sous forme de BD, N. Méndez note qu’elle rompt (en partie du moins) avec la tradition anarcho-syndicaliste en critiquant, hors de toute organisation, le principe même du travail dans la restauration et ses conditions, à savoir notamment la division du travail et le salariat induits par le capitalisme.
Conçu finalement un peu comme une revue de littérature, c’est-à-dire réunissant et synthétisant divers travaux sur le sujet, le livre permet d’avoir une idée générale des liens forts entre la pratique anarchiste et l’alimentation, et pourra, éventuellement, fournir un point de départ pour approfondir tel ou tel cas historique ou contemporain, et bien-sûr donner des envies… Il y a justement, pour conclure, des recettes, dont une soupe végétarienne réalisée à Barcelone pendant la révolution espagnole, ainsi qu’un petit répertoire, évidemment pas exhaustif, d’autres expériences actuelles.
Dutal