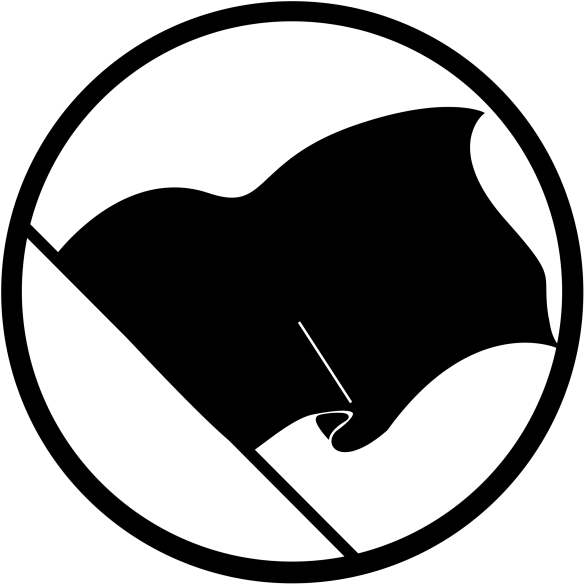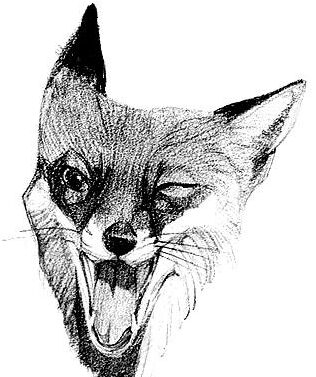Le Sens du vent. Notes sur la nucléarisation de la France au temps des illusions renouvelables
d’Arnaud Michon, éd. L’Encyclopédie des nuisances, 2010.

Reprenant une brochure d’un collectif libertaire (lié à l’organisation anarcho-syndicaliste CNT-AIT), Le Sens du vent a été édité il y a déjà 15 ans (2010)… Pourtant, le livre reste globalement pertinent concernant le cœur de son sujet : les énergies dites renouvelables dans une société nucléarisée. Les 2 modes de production d’électricité sont en effet aujourd’hui toujours en plein développement, tandis que leurs contestations respectives paraissent de plus en plus difficiles à mener pour des raisons diverses, dont le contexte culturel et la répression.
Ce faisant, lire Le Sens du vent demeure très utile puisque l’auteur, avec un ton parfois ironique, y démonte en trois parties les « illusions renouvelables », à partir de l’exemple de l’éolien industriel. Cette précision (reprise p. 50) vise à souligner que le problème n’est évidemment pas le principe d’une énergie produite par le vent, ni même du petit éolien, généralement domestique, mais bien celui des « centrales éoliennes » (souvent nommées, de manière plus consensuelle et positive en évoquant la nature, des « parcs » voire des « fermes », p. 10). Pour l’auteur, qui expose sa thèse d’emblée, les éoliennes sont (présentées comme) des solutions avant tout techniques, qui seraient en fait d’ailleurs d’un faible intérêt écologique, pour répondre à des « besoins » qui ne sont jamais discutés. En effet, elles permettraient surtout de soutenir un ordre économique et politique qui nécessite de fait une accumulation de sources de production énergétique, tout en devant aujourd’hui se présenter comme « vert ». Le livre aborde ainsi la question des énergies renouvelables d’un point de vue politique large, incontournable pour en cerner réellement toutes les implications actuelles.
La première partie s’ouvre sur un rappel de la place spécifique et extrêmement importante du nucléaire pour l’État français (80 % de la production électrique). S’en suit alors une critique plutôt claire du nucléaire, évoquant notamment la pollution par les mines d’uranium en amont, les risques à l’usage, la gestion impossible des déchets ensuite ou encore le lien entre le nucléaire civil et militaire. Selon l’auteur, il y aurait toutefois des mutations du secteur nucléaire à prendre en compte : sortant de l’image du secret que l’on associe souvent au nucléaire, l’État jouerait depuis lors la fausse « transparence » (p. 42), se préparant même aux catastrophes par la simulation, et tenterait une forme de décentralisation (mini-centrales, gestion du risque à échelon locale, y compris avec les citoyens). Or ces évolutions vont dans le sens du vent que suit la critique dite alternucléaire, critique réformiste du nucléaire, exemplifiée tout le long du livre par les positions de Greenpeace et du Réseau « Sortir du nucléaire ».
Pour l’auteur, ces deux associations porteraient en effet un discours attentiste et peu exigeant contre le nucléaire, en participant à une forme de co-gestion, dans un rapport de déférence à l’Etat auprès duquel elles font du lobbying, croyant à une transformation écologique par le haut, voire par une sorte de nécessité rationnelle qui s’imposerait d’elle-même aux Etats. Sont évoquées par exemple l’affirmation de préférences entre tel et tel réacteur pour Greenpeace, qui participe aussi aux simulations d’accident, ou la formulation de solutions pour continuer à produire de l’énergie massivement par d’autres moyens, comme l’éolien, pour le Réseau. En somme, ces « […] alternucléaires prétendent sortir du nucléaire sans sortir de la société qui le produit » (p. 45) et qui estime en avoir besoin, adoptant ainsi une logique de croissance. La présentation de cette critique molle du nucléaire, bien intégrée au discours hégémonique, permet de remettre en contexte la promotion de l’éolien comme solution illusoire.
La deuxième partie aborde donc plus spécifiquement l’éolien industriel, plutôt consensuel sur le plan médiatique et, comme dit précédemment, défendu par des asso’s comme le Réseau « Sortir du nucléaire ». Par un détour technique d’abord, peut-être un peu trop bref et qui aurait mérité d’être mieux sourcé, l’auteur explique comment est fabriquée une éolienne, dénonçant les traitements du mats et les fibres pour les pales, en passant, pour les aimants, par l’extraction de terres rares (notamment en Chine, avec des acides très polluants). Il évoque aussi des difficultés d’entretien et plus largement une faible efficacité (cf. facteur de charge1), qui supposerait alors d’augmenter le nombre d’éoliennes (seulement 1,5% de la production électrique en 2010, pour 2900 éoliennes, il en aurait fallu 100 000 afin de remplacer le nucléaire en produisant la même quantité d’énergie). En d’autres termes, l’éolien industriel apparaît comme peu crédible du point de vue productif si l’on espère produire la même quantité d’électricité. Une analyse similaire est proposée ensuite concernant les panneaux photovoltaïques : ces énergies renouvelables seraient promues en fait surtout pour légitimer un modèle social, économique et politique, via une sorte de greenwashing plus ou moins conscient, au point de proposer un tourisme énergétique pour visiter des installations éoliennes ou photovoltaïques par exemple.
Le cœur du propos, davantage politique que technique donc, porte sur ce qui est appelé l’ « idéologie citoyenniste du renouvelable » (p. 53), que l’auteur retrouve dans un document qui avait été publié par le Réseau « Sortir du nucléaire », où la sobriété énergétique se cantonne aux petits gestes individuels et domestiques (du type : mettre en veille ses appareils…) à côté de la promotion de l’éolien. Prise dans cette optique peu ambitieuse, celle-ci s’appuie sur des arguments très subjectifs, vantant l’esthétique et le potentiel touristique, et, plus discutable encore, une prétendue dimension démocratique… Or, qui décide vraiment de l’installation de ces éoliennes ? Et qui contrôle réellement leur production et les objectifs de cette production ? Ainsi, l’idéologie citoyenniste implique, d’un côté, une focalisation sur des pseudo-solutions techniques, toujours gigantesques, qui rencontre en fait les intérêts des industriels comme par exemple Total ou Areva, y voyant de leur côté une « rente parmi d’autres, mais surtout un commode alibi vert » (p. 79). D’un autre côté, on compte sur les individus, considérés comme des citoyens (en substance : des gouvernés, dociles, restant dans le cadre institutionnel imposé par les gouvernants) pour faire des efforts en vue de « prendre en charge les problèmes insolubles de la société industrielle », le tout dans une sorte « d’autogestion parodique » (p. 85). De fait, comme une sorte d’évidence indépassable, c’est bien le modèle productiviste que vient soutenir l’éolien industriel, où s’accumulent les sources d’énergie pour produire plus.
La troisième partie, la moins attendue peut-être mais pas la moins intéressante, est une critique des (rares) critiques de l’éolien. Dans la mesure où le livre est écrit dans cette perspective antinucléaire assumée, l’auteur ne s’arrête donc pas sur les critiques pro-nucléaires des énergies alternatives, mais sur deux écueils en effet importants d’une critique de l’écologie plus ou moins radicale ou anti-industrielle :
– le contre-argument de la dégradation des paysages, qui n’est pas fausse, mais qui risque de se limiter à une opposition tronquée, du type « pas dans mon jardin », ne remettant pas en cause le problème pour les autres espaces et se prêtant particulièrement bien à une récupération électorale. En pratique, cela donne d’ailleurs souvent seulement du lobbying, des pétitions et le choix de la voie juridique comme unique action. Ainsi, on tombe sur une forme de « localisme » (p. 90) qui perd la dimension universelle de la critique des énergies renouvelables, ces dernières étant en fait articulées à une forme d’autoritarisme, de nucléarisation et d’industrialisation qui menacent la planète entière.
– la focalisation sur l’intermittence de l’énergie éolienne et sur sa nécessaire complémentarité du thermique, émetteur de CO2. Même si c’est vrai techniquement et que le dérèglement climatique est un phénomène grave, cela renforce l’idée d’une catastrophe dont seul l’Etat pourrait nous sortir. Or, en réalité, pas un acteur (ni Etats, ni entreprises, ni assos) n’imagine que l’éolien industriel va être autre chose qu’une énergie supplémentaire et complémentaire à l’existant, tandis que le nucléaire lui-même nécessite une production thermique croissante pour les pics de consommation.
C’est tout le secteur économique qui, très gourmand en énergie, demande à être revu. Il est évident que la culpabilisation individuelle, l’action par « petits gestes » domestiques n’a aucun sens pour qui veut être véritablement conséquent, d’autant plus qu’un tiers de l’électricité est produite pour l’industrie et un autre tiers pour le secteur tertiaire – et l’électricité ne constitue d’ailleurs que 25% de l’ensemble de la consommation énergétique de la France (en 2010). En conséquence, les solutions à la crise écologique sont ailleurs… d’autant que le problème est, précise l’auteur, tout à la fois environnemental, concernant directement la survie, mais aussi social, interrogeant les conditions de vie. Une approche émancipatrice de la question énergétique sera donc « anticapitaliste, anti-industrielle, anti-scientiste et anti-étatique » (p. 105). Ce qui est sans doute vrai, même si deux autres dimensions mériteraient d’être nuancée dans cette critique dite « anti-industrielle », dont l’éditeur du livre, l’Encyclopédie des nuisances, est un fer de lance :
- (1) la citation du « scientisme » comme problème, évoqué à la fin mais pas défini, et qui risque de conduire à une critique désincarnée, voire idéaliste ou mystique, en tout cas comme souvent beaucoup trop vague de « la science », et ;
- (2) le refus de la projection dans des solutions, qui donne l’impression d’une impuissance à envisager clairement des alternatives politiques (et donc nécessairement aussi techniques). Le risque étant, par exemple, de laisser libre cours à des conceptions et usages plutôt individualistes voire survivalistes de l’électricité par exemple.
Sans doute n’était-ce pas le lieu (ni l’époque ?) mais de fait, alors que l’ensemble conduirait à conclure dans le sens de l’anarchie, le terme n’apparaît jamais – on parle toutefois « d’autonomie individuelle et collective » (p. 105). A force d’éviter, en partie à juste titre, de formuler des « « propositions » » (p. 104), ne risque-t-on pas de perdre un appui important pour cette « autonomie » ? Si la question excède sans doute de beaucoup les prétentions de l’ouvrage, et ne pourrait être que le fruit d’un long travail collectif, il semble quand même déterminant de pouvoir penser concrètement des modes d’organisations et de vies, en intégrant la question cruciale de la définition et de la prise en charge des besoins et moyens énergétiques. Cela permettrait justement d’envisager autre chose qu’un programme général à appliquer partout et par le haut, comme le fait un Etat, afin de construire au contraire une société potentiellement émancipée du nucléaire certes, mais aussi débarrassée plus largement du capitalisme (vert ou non), par ailleurs moteur actuel de ces « illusions renouvelables ».
Dutal
Note 1 : Le facteur de charge est le rapport (en pourcentage) entre la puissance théorique maximale et la production réelle sur une année d’une éolienne, et il serait d’environ 20% pour l’éolien en france en 2009 (pp. 54-56), du fait de la technologie et de l’intermittence du vent.